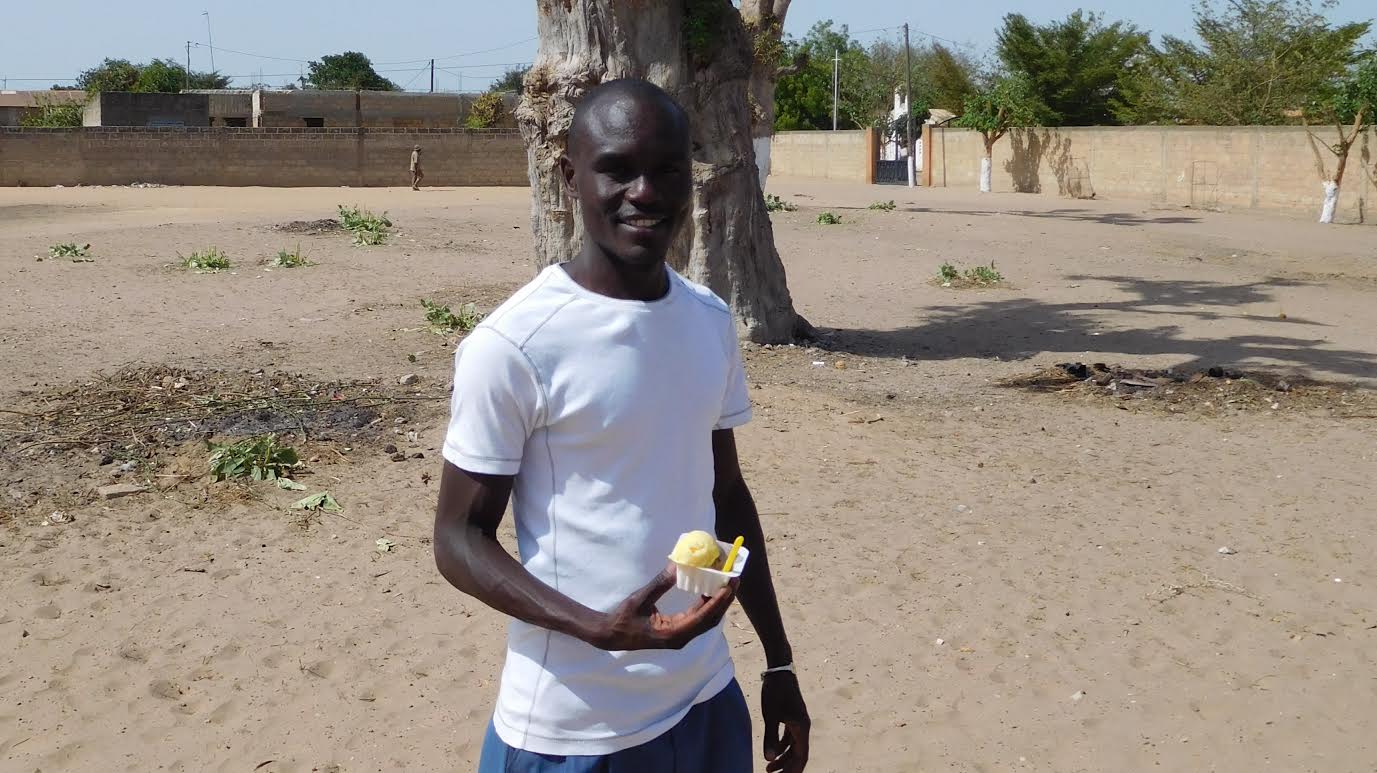Que se passe-t-il en Belgique et en France avec les femmes racisées face aux forces de l’ordre ?
Trois femmes, trois histoires, un même schéma. Grâce.T, Illa et Christelle Victoire Killy ne représentaient aucune menace, pourtant elles se retrouvent en situation de vulnérabilité extrême face aux forces de l’ordre.
Dans deux cas, elles rapportent avoir subi des remarques sexistes et racistes, parfois hypersexualisantes.
Au-delà du racisme et du sexisme, elles sont avilies, réduites à des corps à contrôler ou à sexualiser. Cette déshumanisation s’accompagne d’une violence disproportionnée : Grâce.T et Christelle, toutes deux plaquées au sol par plusieurs hommes, incarnent l’écho persistant de stéréotypes coloniaux sur la « force » supposée des corps noirs.
16 novembre 2024, Saint-Gratien (France) : Christelle Victoire Killy
Christelle, 29 ans, étudiante en droit et coach sportif, se rend au gymnase pour récupérer les enfants qu’elle entraîne au basket. Sur la route, elle est arrêtée par la police qui lui indique que la voie qu’elle s’apprête à emprunter est interdite, en raison d’un défaut de signalisation. Le panneau étant peu visible, cette route reste largement empruntée au quotidien — une voiture passe d’ailleurs devant elle sans être inquiétée. Christelle obtempère immédiatement, fait demi-tour et quitte les lieux en termes cordiaux, malgré son agacement.
Quelques minutes plus tard, elle constate que la police la suit. Elle est de nouveau interpellée : une policière l’accuse alors de l’avoir « tchipée », accusation qu’elle conteste fermement. Rapidement, plusieurs agents arrivent en renfort. La situation s’envenime : elle est extraite de son véhicule, plaquée au sol, étouffée et menottée.
« T’es née au Cameroun… Les femmes noires ont de belles formes… j’adore les femmes noires et vos formes… »
Lors de son interpellation et de sa garde à vue, Christelle rapporte avoir subi ces propos sexistes et racistes de la part d’un policier, dans un contexte où son corps était réduit à un objet de fantasme.
2025, Paris (France) : Illa
Illa, chanteuse révélée par l’émission The Voice, circule à vélo dans Paris lorsqu’elle est arrêtée par trois policiers. Selon son témoignage, elle leur présente ses papiers mais la discussion dégénère. L’interpellation se transforme rapidement en épreuve traumatique : elle affirme avoir été menottée, placée dans une voiture de police, puis retenue quatorze heures dans une cellule mixte, entourée d’hommes sous influence, sans protection policière.
« Ce sont les minutes les plus longues de ma vie, où je me suis demandé ce qu’ils allaient me faire. »
Elle subit des humiliations sexistes et racistes, et sa parole est systématiquement dévalorisée. Après sa libération, elle revient sur place avec son père pour demander les images des caméras de surveillance et embarquées, mais on lui refuse l’accès, les caméras étant « en panne ».
8 août 2025, Bruxelles (Belgique) : Grâce.T
En Belgique, Grâce.T, congolaise résidant à Bruxelles, voyage en train avec deux proches venues de Norvège, toutes d’origine congolaise. À la gare de Vilvoorde, l’automate pour acheter les billets est en panne. Elles préviennent alors un conducteur qu’elles achèteront leurs tickets à bord, comme le permet la réglementation. Le conducteur, visiblement agacé, leur lance :
« C’est toujours la même chose avec vous… »
Une fois arrivées à Bruxelles-Nord, des agents de Securail les interpellent malgré tout pour absence de titres valides et leur demandent de descendre du train. La confrontation dégénère : Grâce.T est plaquée au sol, menottée et accusée de rébellion tandis que ses deux proches sont accusées à tort de posséder de faux papiers. Ces accusations apparaissent d’autant plus injustifiées qu’elles avaient toutes des documents authentiques et semblent motivées par un préjugé racial lié à leur couleur de peau.
Ces trois cas ne sont pas sans rappeler : Urselle Bilegue, 2017, Meise (Belgique)
En 2017, Urselle Bilegue, Belge d’origine camerounaise, vit une scène de violences policières à son domicile à Meise. Souffrant alors d’un cancer et sous traitement de chimiothérapie, elle appelle la police après la visite d’un huissier dont elle doute de la légitimité. Malgré sa régularité et son absence de menace, Urselle est menottée, plaquée au sol et insultée par les agents, dans une brutalité qui rappelle tristement les récits plus récents. Son témoignage souligne que ces pratiques ne datent pas d’hier. [Pour plus de détails, voir son interview en vidéo.]
Une même logique derrière des faits dispersés
Ces événements se déroulent dans des contextes différents ; Belgique, France ; gare, rue, domicile, voiture. Ils impliquent des profils variés : une fonctionnaire mère de famille, une artiste, une étudiante et coach, une patiente en traitement. Pourtant, un point commun les relie : leur identité de femmes noires.
-
Elles ne représentaient aucune menace réelle.
-
Leur corps a été immédiatement perçu comme un objet à maîtriser physiquement (plaquage, menottage, mise au sol).
-
Elles ont subi des propos sexistes et racistes, révélant une hypersexualisation malsaine dans un moment de vulnérabilité.
Le prisme de la misogynoir
Pour comprendre ces faits, il faut mobiliser le concept de misogynoir, formulé par la chercheuse et militante féministe noire Moya Bailey (2008). Ce terme désigne l’oppression spécifique vécue par les femmes noires, au croisement du racisme et du sexisme.
La misogynoir éclaire plusieurs mécanismes visibles dans ces récits :
-
la réduction des femmes noires à leur corps, perçu comme plus « fort » ou « bestial », justifiant une violence disproportionnée ;
-
l’hypersexualisation, où elles sont humiliées à travers des propos sur leurs formes, leurs origines ou leur prétendue disponibilité sexuelle ;
-
une déshumanisation institutionnelle, où leur parole compte moins que celle des forces de l’ordre et où leurs droits sont niés.
Une société en question
Ces récits posent une question essentielle : pourquoi des femmes noires, qui ne représentaient aucune menace immédiate, ont-elles été traitées comme des dangers à neutraliser ?
D’abord, ces faits révèlent un rapport d’autorité genré et racialisé. Dans plusieurs cas, ce sont des hommes policiers qui se sont servis de leur force physique pour maîtriser des femmes isolées. La disproportion est flagrante : il faut plusieurs agents pour plaquer au sol une seule femme, comme si leur corps incarnait une supposée puissance qu’il faudrait dompter. Cette logique renvoie à de vieux stéréotypes coloniaux sur la « force bestiale » attribuée aux corps noirs, y compris féminins.
Ensuite, ces violences ne s’arrêtent pas à l’arrestation : elles se prolongent dans des paroles humiliantes. En hypersexualisant les victimes, les agents entretiennent une relation de domination où la femme noire n’est plus un sujet de droit mais un objet de fantasme et de contrôle. Cette dynamique crée un mélange de peur et d’humiliation qui dépasse la seule interpellation policière : elle touche à l’intégrité même des personnes.
Enfin, ces cas montrent le déficit de protection institutionnelle : caméras « en panne », plaintes classées sans suite, absence de réponses de l’IGPN… Tout se passe comme si le témoignage des victimes comptait moins que la « parole de la police ». Cela contribue à renforcer le sentiment d’impunité et à faire peser sur ces femmes la peur constante d’être à nouveau réduites à leur vulnérabilité.
En filigrane, ces faits interrogent notre société : quel type de contrat social est possible lorsque certaines citoyennes sont systématiquement considérées comme suspectes, moins crédibles, moins dignes d’être protégées ?
Le vrai danger, ce ne sont pas ces femmes : c’est un système qui les réduit à des corps à maîtriser et à des voix à faire taire.